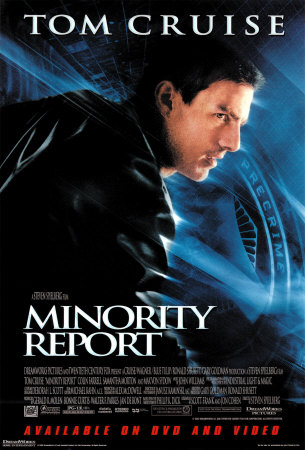This is a story of boy meets girl, but you should know upfront, this is not a love story
L'avertissement est lancé : pas de blagues lourdes, pas d'histoire d'amour facile et gaga, on ne va pour faire le numéro du « et ils vécurent heureux pour toujours, avec trois marmots, un prêt hypothécaire et une furieuse envie de partir se dorer le chicon à Tahiti, quand les enfants seront à l'université ». 500 days of Summer est un film d'une nouveau genre, un film sur l'amour mais qui ne tombe pas dans les clichés actuels, ce qui, soyons réalistes, est aussi rarissime que de l'essence à 5 francs le litre.
Dès l'instant où Tom (Joseph Gordon-Levitt) a posé les yeux sur Summer (Zooey Deschanel), la nouvelle assistante de son patron, son petit coeur a arrêté de battre, a fait trois bonds dans sa poitrine, et sa respiration, a enfin repris, après une absence de quelques secondes : Tom a fondu devant les yeux bleus de Summer, sa taille parfaite, son petit look sixties rangé. Et Summer? Le spectateur n'en saura rien jusqu'à un échange langoureux de salive devant des photocopieuses, quelques temps plus tard, car, voyez-vous, la jeune fille est l'illustration de la femme parfaite pour Tom, qui est d'ailleurs sûr et certain qu'elle est « the one ».
Les bonnes choses ont une fin, et Tom se fait assez violemment larguer, devant une assiette de pancakes, en étant comparé au couple de Sid et Nancy, le genre de poisse culturelle qui arrive douloureusement. Malgré un état de délabrement psychologique certain, Tom veut récupérer Summer, et... Il est temps de s'arrêter ici, le résumé en dit déjà trop.
500 days of Summer a été traduit en 500 jours ensemble, choix peut-être logique, mais légèrement falsificateur du film : le couple ne reste pas 500 jours ensemble, les 500 jours, c'est la durée de l'envoûtement dont Tom est victime, passant de l'amour fou à la haine, et puis, tournez manège, retour en arrière niveau émotionnel.
I love her smile. I love her hair. I love her knees. I love how she licks her lips before she talks. I love her heart-shaped birthmark on her neck. I love it when she sleeps
Summer est à peu près la fille idéale : belle, avec un sens du look évident, une voix adorable, des goûts musicaux géniaux, un humour décapant. Néanmoins, toute médaille a son revers, et plus le film passe, plus des défauts font leur apparition : la peur de s'attacher, un caractère de cochon, des phases où elle devient étrange par son comportement, frôlant l'inexplicable et le bizarre.
I hate her crooked teeth. I hate her 1960s haircut. I hate her knobby knees. I hate her cockroach-shaped splotch on her neck. I hate the way she smacks her lips before she talks. I hate the way she sounds when she laughs
 S'il faut retenir quelques éléments du film, autant déjà évoquer la musique (The Smiths, Feist, The Black Lips, The Temper Trap, Wolfmother et She & Him, le groupe de la mademoiselle Zooey Deschanel), et le choix de mélanger les jours, de ne pas présenter une linéarité, de revenir aux premiers jours, et de repasser aux derniers. Bien que le film, malgré ce désordre historique, suit une certaine chronologie (à partir de la rupture jusqu'au fameux 500ième jour) à laquelle on ne cesse d'insérer des flashback qui expliquent ce qui se passe en définitive, amenant souvent un regard neuf sur une scène passée.
S'il faut retenir quelques éléments du film, autant déjà évoquer la musique (The Smiths, Feist, The Black Lips, The Temper Trap, Wolfmother et She & Him, le groupe de la mademoiselle Zooey Deschanel), et le choix de mélanger les jours, de ne pas présenter une linéarité, de revenir aux premiers jours, et de repasser aux derniers. Bien que le film, malgré ce désordre historique, suit une certaine chronologie (à partir de la rupture jusqu'au fameux 500ième jour) à laquelle on ne cesse d'insérer des flashback qui expliquent ce qui se passe en définitive, amenant souvent un regard neuf sur une scène passée.
500 days of Summer n'est pas spécialement un « feel good movie », car, après tout, Tom s'en prend quand même dans la tronche, on ne rigole pas toujours (ça rappelle sans doute les premières ruptures, les égratignures passées), sans tomber dans le drame larmoyant quand même. Cela dit, certaines scènes ont un quota d'humour fort élevé.
Les acteurs principaux sont mignons, le sourire de Joseph Gordon-Levitt vaut toutes les promesses d'une vie meilleure, le regard ambivalent de Zooey Deschanel tombe un peu comme un ensorcellement soudain, et il est compréhensible que Tom tombe amoureux de Summer.
Cependant, la réalisation de Marc Webb est un peu inégale : parfois, des plans à frémir (la main de Joseph qui essaye d'attraper celle de Summer, qui, par un geste presque violent, l'évite), et à d'autres moments, un manque de manières alors que le ton de la scène s'y prête.
Le film prend une tournure différente vers la fin, amenant une réflexion sur le Destin ou le Hasard dans les relations, les choix. Est-ce la chance qui fait que nous sommes ensemble parce que nous nous sommes rencontrés dans un bar, au même moment, ou le Destin, car, si j'avais été au cinéma à la place, nous ne nous serions jamais vus?
Le film s'engage dans une direction de réponse, certes blasante, mais ne nuisant aucunement à l'histoire en elle-même qui reste un petit bijou agréable, mettant un peu de baume au coeur.